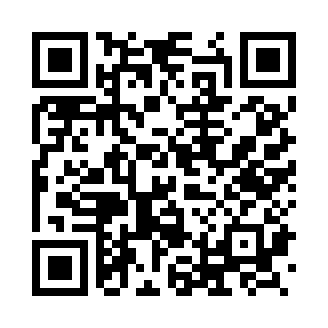Le langage graphique imaginé par Jacques Bertin se veut normatif et il s’est largement imposé dans le domaine de la cartographie et de la visualisation de l’information en France et aux États-Unis.
Visant à produire des images compréhensibles à un moindre « coût mental », le système repose sur l’organisation des données, mais aussi sur une analyse des effets des signes graphiques sur notre perception. À partir de là, Bertin élabore des règles - qu’il pense universelles - pour le traitement visuel de données.
En raison de la technicité de la méthode, son apprentissage est toutefois assez difficile pour des non spécialistes. Les cartographes occasionnelles peuvent cependant découvrir dans ce traité des règles élémentaires de la représentation visuelle : en fonction des effets produits par la taille, la valeur, le grain, la couleur, l’orientation ou la forme des éléments représentés sur le plan, une carte ou un diagramme seront plus ou moins efficaces.
Or le père de la sémiologie graphique, si l’on se réfère à l’introduction de la première édition de l’ouvrage, appelait de ses vœux une véritable démocratisation de la technique (carto)graphique :
Le dernier écrivain public a disparu de Paris en 1962. C’était le témoin d’une époque où la lecture et l’écriture n’étaient pas encore à la disposition de tous. Si maintenant chacun est “lettré”, c’est que l’UTILITÉ UNIVERSELLE de l’écriture est soudainement apparue. Son apprentissage a été organisé. Une méthode, une grammaire furent établies, et l’enseignement en devint obligatoire.
Or, maintenant apparaît l’UTILITÉ du dessin. C’est en effet un moyen commode de noter, de retenir, de comparer les multiples informations nécessaires à l’exercice d’une activité moderne.
Mais peu de personnes savent utiliser le dessin. Les dessinateurs, les bureaux de dessin jouent le rôle de l’écrivain public et sont surchargés de travail. Dans l’avenir, n’en doutons pas, le dessin utile à commencer par les diagrammes sera à la portée de tous, bons ou mauvais dessinateurs, car le problème est semblable à celui de l’écriture.Chacun écrit, se sert de ce moyen d’expression dans le cours de son existence, sans pour cela être “écrivain”. Chacun, de même, saura utiliser les deux dimensions de la feuille de papier pour formuler ses informations, ayant appris les règles d’utilisation et non de technique. Tout individu scolarisé saura construire une image, indépendamment de la qualité de son trait de plume, comme il sait construire une phrase, indépendamment de la calligraphie des mots. On ne confond plus langage et écriture, tournure de phrase et calligraphie. Mais on confond encore construction d’une image et qualité du trait. Combien de dessins admirablement exécutés et richement reproduits trahissent leur titre et ne communiquent qu’une information dérisoire et inutile ? Que de papier et de couleurs perdus. Tandis que des croquis “malhabiles” mais correctement construits deviennent les meilleurs instruments de la découverte et de la pédagogie.
Sait-on enfin regarder un dessin, répondre avec précision à la question : à quoi peut servir un dessin ? C’est à cette question que nous essayerons de répondre, et les conséquences de cette réponse seront développées en une méthode pratique d’utilisation et de rédaction de la représentation graphique.
Aujourd’hui, la carte semble s’être « démocratisée », notamment par son usage numérique, ce qui en fait un outil familier de la vie quotidienne. En parallèle, on voit surtout émerger la cartographie critique, souvent pratiquée par des non-cartographes qui apprennent à s’approprier ses techniques. Ces personnes réalisent elles-mêmes des cartes sur des sujets qu’elles connaissent bien puisqu’ils concernent leur propre espace de vie. Œuvres individuelles ou réalisées lors d’ateliers collectifs ou participatifs, ces cartes donnent corps à des informations négligées et nouvelles. L’instrument se fait alors un outil des luttes citoyennes : une carte radicale [2].
N’est-ce pas cet usage citoyen de la cartographie que Jacques Bertin appelait de ses vœux ? Dans la conclusion du livre, on lit :
En effet, tout individu scolarisé consacre quelque 5000 heures à apprendre l’expression verbale. Il apprend pendant quelque 500 heures à reproduire un pot, une table ou une anatomie. Il ne consacre pas un instant à apprendre l’expression graphique c’est-a-dire à voir, à dessiner et à prévoir la transformation des individus et des choses au milieu desquels il va lutter pendant soixante années.
Un jour, tout le monde fera des cartes : des contre-cartes, des cartes radicales, des cartes sensibles, expérimentales, informelles, des cartes pour soi et des cartes pour les autres, des cartes pour comprendre et défendre son propre usage de l’espace... sans pour autant être cartographe professionnelle.